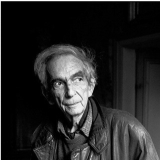 Louis-René des Forêts
Louis-René des Forêts
(1916-2000)
Dossier
Le roman selon Louis-René des Forêts
| Entre déroute et détours - Le discours de Louis-René des Forêts sur l'écriture et le roman, par Xavier Phaneuf-Jolicoeur, 2021 |
|---|
|
« Dites, pourquoi dévaluez-vous méthodiquement toutes vos entreprises[1] ? » demande un journaliste à Louis-René des Forêts (1916-2000) dans une entrevue tenue quelques années avant sa mort, mettant en évidence ce qui frappe quiconque a fait l’expérience des propos de l’écrivain sur son art. « Je dirai une chose qui va paraître tout à fait ridicule », répond l’intéressé, « ou passer pour une fausse modestie, ce qu’elle n’est nullement : en fait, je ne me sens pas doué. C’est la vérité. Je la ressens ainsi[2] ». Il serait difficile de formuler un énoncé plus typique du discours de l’écrivain sur sa démarche, car tandis qu’il confirme et réitère la dépréciation de lui-même sur laquelle on l’interroge, il désigne des oppositions qu’on retrouve constamment chez lui : entre les apparences trompeuses et la sincérité, entre le risible et le grave, entre la fragilité et la plus grande conviction, entre l’échec de l’œuvre et sa poursuite obstinée. Convenons que des Forêts sait décontenancer un intervieweur, notamment par son ostensible réserve, comme lorsqu’il lance d’entrée de jeu en entrevue : « Je n’ai pas grand-chose à vous dire. […] Je n’aime pas parler[3] ». Ou lorsqu’il déclare, dévaluant en bloc toute parole, incluant celle qu’il consacre lui-même à son œuvre : « Celui qui ne bavarde pas ne dit rien, c’est évident. Si je n’étais pas en train de bavarder, je serais silencieux »[4]. Nous verrons qu’il ne met pas une telle circonspection aussi fréquemment de l’avant par seule coquetterie – et nous pouvons déjà noter que ce trait caractérise, à tout le moins sur le plan de la quantité, son travail, des Forêts étant l’auteur d’une œuvre éparse et modeste, marquée d’intervalles de silence. Il a en effet publié, sans s’engager dans une production soutenue et pérenne, une poignée de récits et romans, de la poésie, une sorte d’autobiographie, des chroniques musicales, s’essayant aussi au cinéma, à la traduction et à l’art plastique. Mon étude du discours de des Forêts sur cette œuvre précaire et polymorphe, ainsi que sur l’art littéraire, se déploie en trois parties dans les pages qui suivent. Je me penche d’abord sur la relation contradictoire que l’écrivain entretient avec le langage. Puis j’examine la façon dont sa démarche semble constamment porter les traces du deuil. J’aborde enfin les notions, récurrentes chez lui, de nécessité et de vérité, ce qui nous conduit à observer de plus près la manière dont se construit sa conception de l’art : par dérobades et contestations internes. Je considère en conclusion une expression qui me paraît tout à fait symptomatique du fonctionnement de sa pensée : « Tout se passe comme si ». Le rythme d’un soupir. La réserve est constamment valorisée au fil des commentaires de des Forêts sur l’art, qu’il s’agisse par exemple pour l’écrivain de s’astreindre lui-même à une « sévère économie des moyens[5] » ou de mettre de l’avant dans ses écrits sur la musique un « souci d’économie », une « science du dosage », voire un « laconisme exemplaire »[6]. Au premier abord, on peut noter que, loin d’être abstrait ou motivé par un hermétisme gratuit, le laconisme forestien est explicitement rattaché par l’auteur à des circonstances historiques et sociales. Renvoyant entre autres à l’époque de la Résistance, où un « mot de trop met[tait] tout en péril », comme le rappelle des Forêts dans son œuvre la plus autobiographique, Ostinato[7], elle semble aussi liée à son inquiétude devant la prolifération d’une « parole brouillée, faussaire ou convenue, dont l’abondance est orchestrée par le pouvoir des médias »[8], une surenchère « monstrueuse » qui ne serait à ses yeux ni plus ni moins qu’une « nouvelle forme d’oppression, plus insidieuse et plus généralisée[9] ». C’est d’ailleurs en insistant sur le contexte chargé entourant en 1957 un concert consacré à Anton Webern, l’invasion de la Hongrie par les troupes soviétiques, qu’il affirme trouver chez le compositeur une « expression authentique à l’art musical de [son] temps[10] », un exemple de « laconisme » à une époque « où l’inflation verbale, sinon sonore, est à son comble », constat qu’il étend d’ailleurs au « domaine de la création romanesque »[11]. La concision a peu à voir avec un amenuisement de l’expression chez des Forêts, car il s’agit d’arriver à dire beaucoup en peu de mots, en quoi cette valeur artistique se relie à celle de densité qui revient souvent dans son discours sur l’art. Par exemple, lorsqu’il tente d’identifier en entretien une caractéristique qui relierait les œuvres de quatre écrivains pour lesquels il déclare avoir toujours eu une prédilection sans faille, Shakespeare, Pascal, Rimbaud et Gerard Manley Hopkins, il observe : « En dépit des apparences, ils ont quelque chose de commun, l’éclat, l’audace et la densité abrupte de la langue : tout y semble procéder par bonds »[12]. De même, se disant en réaction contre Faulkner « qui se perd dans la verbosité », il explique que « c’est sûrement pour [s]’y opposer [qu’il a] voulu faire, dans [son recueil de] nouvelles, quelque chose de très dense »[13]. C’est encore « l’extrême densité qui exclut tout remplissage poétique, la syntaxe hardie, le rythme abrupt et syncopé » qu’il célèbre ailleurs chez Hopkins[14]. Enfin, dans une chronique musicale de 1946, où il applaudit les recherches, même échouées, de certains romanciers de son temps, il dénonce chez les compositeurs l’oubli de la valeur de l’austérité, dont on conçoit bien le rapport à la réserve et à la densité, et qui signifie pour lui : « dégoût de l’effet, recherche obstinée de ses propres lois, exigence à l’égard des moyens utilisés[15] ». Pour des Forêts, la littérature implique, avant toute autre préoccupation, narrative ou esthétique, un exigeant travail langagier[16]. Le but authentique de l’écrivain, explique-t-il dans une lettre, est de « se créer un langage »[17]. Pourtant, par une contradiction apparente quoiqu’assez commune durant la période à laquelle il appartient, le travail appliqué de la langue se conjugue chez lui à un souci qui le corrode de l’intérieur : un scepticisme marqué devant la parole. Ainsi, des Forêts peut affirmer, d’une part, qu’ « il faut, enfin il faudrait, se laisser porter par la langue »[18] ou que s’il n’est pas « conduit par le langage, [il ne fait] rien de bon, rien qui [lui] paraisse valoir d’être dit ou qui soit au plus près de [s]a vérité propre »[19], tandis que, de l’autre, il admet aussitôt « que cette subordination de la pensée au langage a quelque chose de dément, d’autant qu’elle s’accompagne chez [lui] d’une grande défiance du langage »[20]. Il semble alors que l’étrange rapport à la langue décrit par des Forêts tiraille l’écrivain entre la sujétion à celle-ci et l’effort hardi pour la contrecarrer et la maîtriser, entre la contrainte et l’exercice vigoureux de la volonté artistique. Ainsi, suivre le mouvement du langage ne peut signifier pour des Forêts un abandon nonchalant à l’enthousiasme de l’écriture, qui recèle lui aussi ses menaces. Parlant de la rédaction du Voyage d’hiver, roman auquel il a renoncé après des années de travail, et qu’il presque entièrement détruit[21], des Forêts explique par exemple qu’il refusait les « bouffées d’inspiration », les considérant « suspectes »[22]. Et commentant une autre œuvre, poétique celle-là, s’il dit s’être « peut-être laissé là plus qu’ailleurs […] porter par la langue », il ajoute aussitôt qu’il existe un « danger », un « risque » à tomber dans une « certaine complaisance verbale » ou « dans un lyrisme qui est parfois un peu suspect »[23]. Cet obscur péril en est un que des Forêts semble s’imposer à lui-même, devenant lorsqu’il écrit la proie d'un étrange « phénomène de dédoublement »[24]. Tandis que l’auteur en lui est « tenu en bride » par l’autre partie de lui qui en fait son propre lecteur, il se trouve à incarner « en même temps les deux membres du couple », mais sur le délicat mode d’une « dualité dont chacun des termes exclut radicalement l’autre »[25] :
On retrouve, il me semble, une tension analogue lorsque des Forêts emprunte à la musique la notion de rythme pour décrire son idéal littéraire. Le rythme a trait, chez l’écrivain, à la laconique densité qu’il place au centre de sa conception de l’art et de la littérature, car écrire consiste selon lui à « exprimer, par une concentration de plus en plus grande des éléments rythmiques, la pulsation intérieure, la scansion de l’être[27] ». C’est cette notion qu’on retrouve par exemple dans ce souci de « l’organisation rythmique des différents plans » qu’il décrit dès 1949 dans une lettre où il aborde Le voyage d’hiver[28]. Il est, de même, remarquable que le mot Ostinato, dont des Forêts explique en entrevue qu’il signifie le « maintien d’une formule rythmique pendant tout ou partie d’une œuvre musicale[29] », soit employé comme titre de la dernière œuvre publiée de son vivant. En outre, dans Voies et détours de la fiction, il explique qu’il se concentre sur les « relations internes » entre les mots, cherchant l’unité dans « une organisation rythmique en accord avec le mouvement profond qui [l]e porte[30] ». Ce recours à la métaphore rythmique pour désigner le mouvement secret qui se déroule en l’écrivain, et son rapport au langage, incarne bien le paradoxe de la liberté dans la contrainte qui caractérise le travail de des Forêts : comme un musicien doit suivre le tempo donné, tout en jouissant d’une grande autonomie dans son interprétation d’une partition, l’auteur est tout à fait libre… à condition toutefois de demeurer fidèle à ce battement intérieur qui s’impose à lui. C’est d’ailleurs ce que l’écrivain dit envier au domaine de la musique : « une liberté dans la rigueur »[31]. Des Forêts aime à citer une formule qui synthétise bien ce rapport tendu que l’écrivain entretient à ses yeux avec le langage, sorte d’idéal poétique qu’il emprunte au compositeur Arnold Schönberg : un « roman en un seul soupir[32] ». Cette énigmatique aspiration fait écho à plusieurs des qualités poétiques que nous avons identifiées jusqu’à présent : caractérisée par le laconisme que recherche des Forêts, exprimant beaucoup par le peu, elle renvoie à la fois à une elliptique retenue et à l’abandon à un irrésistible mouvement intérieur. Mais si un soupir est souvent lourd de signification, cette dernière peut être fugace : ici, elle semble moins se rapporter au soulagement ou au plaisir esthétique qu’au désarroi devant ce qui place toujours l’œuvre forestienne hors d’atteinte. Les moyens du deuil. On repère constamment dans le discours de des Forêts une singulière nécessité pour l’écrivain de renoncer à lui-même pour trouver le vif langage de l’œuvre : pour « garder sa vitalité, on doit perpétuellement se quitter et se retrouver, mais de telle sorte que l’endroit qu’on a quitté et l’endroit où l’on revient soient les mêmes, et pourtant différents »[33]. L’écriture semble ainsi avancer par délestages et deuils, la littérature ne pouvant s’ériger que dans une lacune : il y a « toujours », affirme des Forêts, « dans le fait d’écrire, un phénomène de compensation »[34]. À ses yeux, « l’écrivain n’est pas outillé » si on le compare à d’autres artistes, au peintre ou au musicien : « La matière lui manque »[35]. Une telle comparaison n’est pas anodine, car l’écriture tient littéralement lieu chez des Forêts d’un art qu’il décrit souvent comme sa véritable vocation, la musique. « [E]ntre la littérature et la musique j’aurais de beaucoup choisi la musique comme moyen d’expression »[36] ; « [c]’est cela que je voulais, plutôt que d’écrire[37] ». Dans un autre entretien, il va jusqu’à avancer que cette passion contrariée explique « pourquoi, peut-être, [il] écri[t] si peu », son laconisme découlant sous cet angle de ce que l’écriture est pour lui « une espèce de pis-aller »[38]. Qu’on prenne tout à fait au sérieux ces remarques ou non, il demeure que des Forêts revient souvent sur cette possibilité qu’il ait « manqué [s]a vocation », tout en insistant sur le caractère douteux de la contrepartie que lui apporte l’écriture : « [m]on inaptitude à la musique ne se console pas d’une quelconque et d’ailleurs discutable aptitude à la littérature »[39]. Néanmoins, l’écrivain reconnaît que s’il a pu tenter « d’assouvir par les mots une passion contrariée de la musique », c’est par un travail musical de la langue, en « variant les jeux d’écriture, en passant à la prosodie, à la rythmique et même au poème »[40]. Soudain, on comprend mieux de quelle façon la musique hante la pensée forestienne de la littérature, notamment à travers des notions comme celle de rythme ou de voix[41]. C’est qu’elle inscrit dans l’écriture une aspiration condamnée d’avance à demeurer inapaisée, le rêve mélancolique d’une forme d’expression qui dépasserait les mots, qui résonnerait avec « l’évidence d’un chant »[42]. Chez des Forêts, l’artiste paraît toujours entretenir un rapport de séparation avec ses œuvres, passées comme à venir. Avançant par « rupture » avec les tentatives précédentes[43], qui constituent d’ailleurs de « sérieux obstacles à l’élaboration de celle qui les suit[44] », et « constamment en instance de divorce avec l’œuvre »[45], l’écrivain présente ses livres comme un désaveu de ceux auxquels ils succèdent : « Le bavard, qui forme un texte assez court, était une critique des Mendiants, beaucoup plus développé », de même que « La chambre des enfants, qui est un recueil de nouvelles [qu’il s’est] efforcé de resserrer le plus possible, constitue […] une critique de ce roman trop dilué [qu’il a] jugé impubliable »[46], Le voyage d’hiver. « Je commence tellement de choses que je ne finis pas[47] », déclare en outre l’écrivain. Or, tenace, l’objet du renoncement ou de la perte continue d’habiter celui qui s’en détourne. Si des Forêts affirme s’être senti « délivr[é] du doute »[48] en délaissant son Voyage d’hiver, il admet que « le vide créé par l’œuvre qui ne verra jamais le jour ne peut être comblé » et que, un peu comme la blessure d’un deuil, ce manque « faussera secrètement la perspective de l’ensemble »[49]. Il semble que des Forêts travaille, précisément, à partir de son renoncement à ses aptitudes littéraires, dans une constante « méfiance à l’égard de [lui]-même » et de ses « possibilités d’écrire » dont il dit avoir « toujours douté[50] ». C’est ainsi qu’il peut se reprocher, se retirant les traits spécifiques qu’il valorise, dans une lettre à André du Bouchet, un « manque d’énergie, de densité intérieure, par défaut de cette conviction qui est le ressort et la marque […] d’une vitalité dont [il] [s]e sen[t] […] totalement dépourvu »[51]. « L’autodestruction est une forme de mon esprit[52] », confie-t-il en entrevue, semblant affecté par la même « morbidité auto-destructrice » qu’il diagnostique au poète Hopkins auquel il reconnaît être lié par un « phénomène d’identification »[53]. En réalité, un risque double guette l’écrivain, aux yeux de des Forêts, ce sur quoi nous renseigne sa curieuse expérience du Voyage d’hiver. Évaluant sa situation malaisée, dans une lettre contemporaine à la rédaction de ce livre, il se demande, doutant de lui-même, s’il n’a pas « surestimé ses forces », affirmant être guidé par cette phrase : « Découvrir ce que vous ne pouvez pas faire, puis vous mettre aussitôt à le faire, telle est la règle d’or »[54]. Mais, il explique aussi dans Voies et détours de la fiction que le problème avec cette œuvre était que, « trop préméditée », elle « avait cessé pour [lui] d’être l’impossible »[55]. Ainsi, le livre l’aurait « entraîn[é] dans des voies un peu périlleuses, non pas parce que c’était un livre audacieux », mais plutôt en étant « le contraire d’un livre audacieux »[56] : il serait devenu impossible en cessant d’être impossible. L’antinomie est manifeste lorsqu’il déclare dans une même lettre avoir « abordé des difficultés trop insurmontables » et voir dans l’œuvre les « fruits insipides d’un lâche abandon à la facilité »[57]. Des Forêts le reconnaît explicitement : il a trouvé le découragement « [e]ntre un excès de facilité et un excès de difficulté »[58]. Le danger du succès se manifeste encore lorsque des Forêts, prenant ses distances avec le « nouveau roman », note que ce dernier court le risque « de tomber sous le malheur de la réussite »[59], ce qui n’est probablement pas étranger à sa trop grande préoccupation des questions de « technique romanesque »[60] Mais comment l’écrivain forestien pourrait-il échapper à l’épreuve du deuil, lui qui fait œuvre menacé de toutes parts, « par la réussite » comme « par l’échec » qui le placent « dans une égale insécurité au regard même de ce qu’il a à dire ou transmettre »[61] ? S’il ne s’agit pas, pour des Forêts, qui met un rigoureux travail de langue au cœur de sa conception de l’écriture, de valoriser l’échec pour lui-même – « [q]u’un écrivain assume son propre échec ne doit pas être tenu comme un signe de la maîtrise »[62] –, il faut, selon lui, « préférer l’échec au compromis de la réussite » parce que « l’échec est souvent le prix très lourd dont se paie la réussite »[63]. En d’autres termes, pour l’écrivain, une œuvre n’est, précisément, possible que par ses deuils et ses lacunes : c’est lorsqu’elle porte « une exigence excessive » qu’elle trouve « dans son échec la condition même de sa réussite »[64]. Dans un tel état d’insécurité, et dans l’ignorance du « but [qu’il] poursuit en écrivant, si tant est qu’il y en ait un »[65], le créateur forestien est naturellement mené à se concentrer sur les moyens de l’œuvre plutôt que sur ses fins. « [Q]uelle piètre idée se font de la littérature ceux qui l’entendent comme une activité capable de s’exercer sans considération de ses moyens[66] ! » Or l’attention aux moyens de l’écriture, loin d’être limitée à la technique[67], implique un équilibre qui paraît souvent inatteignable entre ce qui serait de l’ordre de l’austérité, de l’exigence, et d’autres traits qui s’ajoutent parfois, semblant s’opposer aux premiers : l’inspiration, la sensibilité, l’audace. Pour des Forêts, l’artiste peut s’enliser s’il avance trop dans l’une comme dans l’autre de ces directions ; c’est ainsi que l’écrivain peut à la fois reprocher à Messiaen d’être un « flatteur », qui voudrait ravir et envoûter « par la richesse des moyens mis en œuvre », de chercher à agir « directement sur la sensibilité sans passer par l’intelligence[68] » et critiquer Stravinski parce qu’il propose dans son Canticum Sacrum une « œuvre bien construite, mais pétrifiée », « privé[e] de vitalité et d’imagination », « un ouvrage bien fait, mais sans âme et qui aurait pu aussi bien être fait avec d’autres moyens »[69]. Par contraste, chez Webern, que des Forêts cite en exemple, « l’invention mélodique, en vérité prodigieuse » est « sans cesse contrôlée par un souci d’économie sévère, [mais sans qu’] à aucun moment l’austérité qui a présidé à son élaboration ne pèse sur l’œuvre »[70]. On y trouve en somme une « richesse de l’inspiration » qui est « tout entière fonction des moyens choisis et utilisés »[71]. Autrement dit, les moyens d’une œuvre semblent devoir s’imposer d’eux-mêmes, tout comme ils doivent être soumis au « risque de l’échec » qui contraint l’écrivain à faire preuve d’ « une vigilance sans défaut » pour que « chaque obstacle, fût-il esquivé de justesse, ouvr[e] à des possibilités nouvelles et serv[e] comme de tremplin à de nouveaux défis »[72]. C’est ce qui explique que la « rupture » puisse être comprise comme une loi de l’art pour des Forêts : c’est aux prises avec la déchirure constante, le deuil, que l’œuvre se déploie, devant sans cesse « recouvr[er] » son unité perdue[73]. Paraissant toujours, dans son discours sur sa démarche, engagé dans un va-et-vient entre l’échec et la réussite – comme, dans son rapport au langage, entre la volonté et la contrainte –, l’écrivain forestien serait, pour reprendre les mots qu’il applique à Webern « [à] la fois infiniment ambitieux et infiniment modeste », cherchant l’ « alliage insolite de la simplicité et de la quintessence »[74]. Et c’est sans doute à cause de ces exigences colossales et contradictoires que l’écriture a à ruser sans cesse avec ses propres limites. Nécessité, vérité, duplicité. La parole de des Forêts sur son travail est souvent sinueuse, contradictoire, et certaines notions constitutives chez lui, celles de nécessité et de vérité, ne semblent prendre sens que dans leurs duperies et leurs discordances. Dans son discours sur son travail, l’exposition du fond de sa pensée ressemble souvent à une dérobade semblable à celles du narrateur du Bavard, frappé à la fois d’un incontrôlable « besoin de parler » et d’une « impuissance » à trouver quelque chose à dire[75], et dont l’imposture finale, « acte brutal de dévoilement », est aussi « acte subtil de dissimulation »[76]. On s’en convainc en lisant la tortueuse réponse de des Forêts à l’enquête « Pourquoi écrivez-vous ? ». Car tandis qu’il ajoute à une question « troublante » une série d’autres interrogations, évitant soigneusement de répondre à ce qui lui est demandé, il dénonce du même souffle la tentative d’éluder le problème qui consisterait à « s’en tirer par une boutade qui ne serait alors qu’un faux-fuyant, une manière détournée de masquer son embarras »[77]. L’un des principes poétiques auxquels des Forêts se raccroche souvent est celui de nécessité. Cette dernière apparaît par exemple dans une lettre de 1947 où il aborde Le voyage d’hiver : « Si je n’écris pas quelque chose de neuf, qui n’ait à mes yeux un caractère absolu de nécessité et me passionne, ce n’est vraiment pas la peine de prendre la plume[78] ». On notera au passage que l’insistance sur la notion de nécessité surprend chez un artiste qui admet écrire par dépit, dont une part non négligeable de l’œuvre est née de commandes[79], sans compter qu’il confie avoir souvent travaillé « sans savoir où [il] allai[t][80] » ; « sans dessein préalable et sans volonté préméditée »[81] ; « Je ne sais pas du tout ce que je fais ni où je vais quand j’écris »[82]. Si nous savons désormais qu’il faut probablement interpréter la nécessité forestienne comme étant liée à ce rythme intérieur que nous avons évoqué plus haut, celui qui organise l’œuvre à partir de la langue, la notion sort bien nébuleuse des tentatives de l’écrivain d’expliquer l’écriture du Bavard :
Les relations ambiguës entre l’impérieuse nécessité et l’errance se trouvent au cœur des réflexions de des Forêts sur Le bavard. Il explique ainsi dans Voies et détours de la fiction qu’il voit dans cette œuvre une « course tendue du langage qui, devenue son propre objet, se poursuit sans but et ne peut s’achever que dans [un] recours sournois aux figures de la rhétorique », dans des « inversions de forme », des « déplacements ou permutations de significations », des « opérations dont chacune s’annule elle-même et par lesquelles se reproduisent les mouvements contradictoires, les distorsions, les attitudes secrètes et détournées de la pensée »[84]. Si des Forêts identifie dans ces procédés « les signes d’une impossibilité fondamentale pour la conscience narrative » à l’emporter sur une « mystérieuse dualité qui est en elle comme une maladie de l’esprit »[85], il relie aussitôt ces ruses et dédoublements à la notion de nécessité, proposant une image qui est applicable non seulement au Bavard, mais à toute son œuvre :
La nécessité se manifeste comme l’impérative et secrète orientation de l’œuvre qui, parce qu’elle ne peut dessiner qu’un parcours impossible et condamné d’avance, doit être redoublée par des méandres qui permettent, empiriquement, à l’œuvre d’exister. Un phénomène similaire affecte chez des Forêts la notion connexe de vérité, elle aussi centrale à son univers poétique. C’est elle qu’il retrouve par exemple chez des écrivains qu’il dit préférer aux « nouveaux romanciers » : « Breton, Bataille, Blanchot et Leiris qui, dans une œuvre tendue et d’une lucidité exemplaire, ont su réunir en une suprême identité ces notions apparemment antinomiques : poésie et vérité »[87]. Et dans une veine similaire, des Forêts contemple, fugitivement, la possibilité pour l’écrivain de « faire du langage le lieu de la médiation et de la vérité absolue[88] ». La vérité visée par l’art ne peut être, chez lui, qu’élusive, caractère par lequel on constate qu’elle ressemble étrangement à la nécessité : « Écrire, cela suppose une exigence rigoureuse et exclusive, un mouvement vers une vérité toujours plus impérieuse mais toujours plus fuyante, et qui s’affirme comme si essentiel qu’on ne peut s’en écarter sans la certitude de gravement faillir[89] ». Cet aspect évasif de la vérité provient en partie de ce que la « vérité une fois trouvée cesse d’intéresser »[90], mais il a aussi à voir, comme l’écrivain l’explique ailleurs, avec l’intuition selon laquelle l’ « expression vraie cache ce qu’elle manifeste[91] ». Puisque « tout sentiment, toute idée puissante provoqu[e] en nous comme un vide », il en découle que « le langage, s’il écarte ce vide, écarte aussi la vérité, c’est-à-dire, en définitive, la poésie »[92]. Et c’est en reconnaissant la nature fugitive de la vérité poétique, de « [c]e qui se dérobe à l’analyse », en laissant un jeu pour l’esprit, que la musique et la littérature (qui alors s’en approche) tendraient vers leur « nature »[93]. Notons que le romancier n’échappe pas, chez des Forêts, à cette exigence de vérité. Seulement, vu la proximité du roman avec l’illusion, il ne peut s’y plier que par imposture :
Il n’est pas surprenant, alors, que, né de ses sinuosités et déviations, le roman forestien, qui cherche à s’esquiver dans le « possible », soit compris en tant que genre comme « force exceptionnelle de dérivation, de dissociation des apparences dans lesquelles [se stabilise] et [a] tendance à se reposer l’esprit[95] ». Nous avons compris, alors que notre parcours s’achève, que la vérité et la fidélité à la nécessité que des Forêts institue en aspirations capitales pour l’art, ne peuvent être atteintes que par les faux-semblants et les feintes, par des détours constants que doit prendre l’œuvre face au risque de la déroute. C’est ce qui donne à la fois sa puissance et sa précarité à cette pensée de la littérature qui semble sans cesse se dédoubler, dresser des obstacles pour elle-même, puis tenter de les déjouer – courant à chaque instant le risque réel de se trouver entravée pour de bon. Écrivain par hypothèse. Des Forêts emploie assez souvent une formule où l’on peut reconnaître la marque de ces mouvements ambivalents qui caractérisent sa pensée : « Tout se passe comme si ». Dans un passage fascinant de Voies et détours de la fiction, tandis qu’il aborde son usage du pronom je et l’importance de la rhétorique dans son œuvre, plus précisément celui de la « contestation ironique de soi »[96], des Forêts explique : « tout se passe en définitive comme si rien ne pouvait s’accomplir que dans l’impossibilité de son accomplissement »[97]. Cette même expression apparaît de nouveau dans ce texte, alors qu’il aborde les contradictions inhérentes à sa conception de l’écriture : « Tout se passe, on l’a remarqué, comme s’il nous fallait dire une chose et ne dire qu’elle, mais sommes-nous jamais assurés de pouvoir la dire[98] ? » On la retrouve lorsqu’il tente d’expliquer la longue « erreur » de son Voyage d’hiver : « Tout s’est passé comme si l’ambition et l’ampleur de mon dessein l’avaient rendu par elles-mêmes caduc »[99]. Il est en outre assez frappant que la locution lance également la nouvelle Dans un miroir (1960), où elle instaure une discordance dès la première phrase : « Bien que ses visites soient quotidiennes et d’une ponctualité irréprochable, tout se passe chaque jour comme s’il survenait à l’improviste »[100]. Cette formule, que des Forêts n’est évidemment pas le seul à employer, inscrit dans le langage lui-même cette contestation interne que nous n’avons cessé de retrouver chez lui, cet entre-deux si typique de sa pensée[101]. Elle lui permet, par une sorte de duplicité, de s’avancer sans s’avancer, d’évoquer une aporie sans avoir à la résoudre véritablement. Il n’est pas étonnant, alors, que la formule apparaisse quand il aborde ces questions exigeantes qui sont au cœur de sa conception de la littérature : agissant comme marqueur de fiction dans la réflexion poétique elle-même, comme excursion de sa pensée de l’art dans le possible, elle exprime par ce détour l’exigence impossible qui s’impose à lui. Dans ses déviations, cette formule est d’ailleurs caractéristique de la manière même dont des Forêts conçoit la possibilité pour un écrivain de parler de son œuvre. Car pour lui, « il y a toujours quelque chose de vain à vouloir soumettre à l’analyse ce qui n’a pu trouver le moyen de s’exprimer que sous une forme détournée »[102]. Constant dans ses louvoiements, l’écrivain hésite à la fin de Voies et détours de la fiction : mettant d’abord en garde contre le caractère périlleux de sa tentative de commenter son art, il soupçonne ensuite l’interdit jeté sur toute entreprise d’autoélucidation par les écrivains de leur travail d’être entretenu par ceux-ci par fausse modestie et intérêt, avant de revenir à l’idée première selon laquelle toute explication d’une œuvre par un artiste ne peut que la desservir ; il lance enfin, évitant bien de dénouer la question, qu’« on aurait tort de conclure que la preuve est faite de l’impossibilité pour l’écrivain de parler de son œuvre »[103]. C’est, il me semble, avec l’instabilité du « tout se passe comme si », sur le mode de la possibilité et de la conjecture, que des Forêts échafaude sa conception de l’écriture, lui qui, abordant en entretien ses nombreuses contradictions, reconnaît non sans humour que sa situation n’est pas « confortable » et que sa démarche n’est pas « à proposer en exemple »[104]. En somme, tout se passe comme si des Forêts ne pouvait écrire, et penser cette écriture, qu’exposé chaque jour à la menace d’un échec que doit sans cesse contourner l’œuvre pour s’inventer. À un journaliste qui lui demande en 1995 s’il est toujours écrivain, des Forêts donne d’ailleurs ces explications étonnantes : « Je travaille à cette hypothèse, très tôt chaque matin. […] J’écris sur des cahiers d’écolier, le modèle à carreaux et spirale »[105]. Pourquoi ce modèle ? : « Parce qu’on peut arracher facilement »[106]. [1] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 63. [2] Ibid., p. 63. [3] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [4] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 61. [5] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 880. [6] L.-R. des Forêts, « Stravinski et Webern au Domaine musical » (1957), OC, p. 650. [7] L.-R. des Forêts, Ostinato (1997), OC, p. 1092. [8] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 64. [9] L.-R. des Forêts, « Le droit à la vérité » (1958), OC, p. 66. [10] L.-R. des Forêts, « Stravinski et Webern au Domaine musical » (1957), OC, p. 647-648. [11] Ibid., p. 650. C’est moi qui souligne dans tous les extraits, à moins d’une indication contraire. [12] J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 12. [13] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [14] J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 25. [15] L.-R. des Forêts, « Les concerts de la Pléiade » (1946), OC, p. 641. [16] J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 12-13 : « Ce qui m’intéresse chez les quatre auteurs que je viens de citer, c’est la langue, pas nécessairement le propos ». [17] L.-R. des Forêts, « Lettre à Michel du Boisberranger » (mardi mars 1947), OC, p. 99. [18] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 56. [19] J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 21. [20] Ibid., p. 21. [21] Voir A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 62-63. [22] L.-R. des Forêts, « Lettre à André Frénaud » (12 janvier 1952), OC, p. 102. [23] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 68. [24] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 881. [25] Ibid. [26] Ibid. [27] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 879. [28] L.-R. des Forêts, « Lettre à André Frénaud » (mardi 4 septembre 1949), OC, p. 101. [29] J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 13 ; voir aussi A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 70. [30] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 880. [31] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 56. [32] L.-R. des Forêts, « Stravinski et Webern au Domaine musical » (1957), OC, p. 650 ; voir aussi R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [33] L.-R. des Forêts, « Lettre à Michel du Boisberranger » (mardi mars 1947), OC, p. 99. [34] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [35] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 63. [36] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 65. [37] J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 13. [38] D. Bourdet, « Louis-René des Forêts » (1954), p. 132 ; voir aussi R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [39] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 62. [40] Ibid., p. 63. [41] Voir là-dessus D. Rabaté, Louis-René des Forêts. La voix et le volume, p. 14. [42] Voir L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 880 ; voir aussi A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 68, où des Forêts déclare que le chant est un thème dans son œuvre et qu’il incarne une « possibilité de salut » (ce qu’il remet aussitôt en question) ; voir aussi p. 62 : « […] [L]’expression ne devrait pas passer par les mots, mais par autre chose, ne serait-ce que par le visage, les gestes… Le langage finalement pervertit, corrompt la communication tout en en étant naturellement l’instrument indispensable. » [43] Voir A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 60 : « [I]l y a eu évidemment une rupture [dans Le bavard], comme j’en ai éprouvé d’autres par la suite ». [44] L.-R. des Forêts, « Lettre à Michel du Boisberranger » (mardi mars 1947), OC, p. 97-99. [45] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 882. [46] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [47] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [48] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 883. [49] Ibid., p. 884. [50] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 65. Des Forêts répond à une question sur son recueil de récits, La chambre des enfants, mais le commentaire me paraît révélateur de sa vision générale de son œuvre. [51] L.-R. des Forêts, « Lettre à André du Bouchet » (samedi [1970]), OC, p. 112. [52] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4. [53] J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 26. [54] L.-R. des Forêts, « Lettre à André Frénaud » (mardi 4 septembre 1949), OC, p. 101. [55] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 884. Soulignements de des Forêts omis. [56] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 62-63. [57] L.-R. des Forêts, « Lettre à Michel du Boisberranger » (mardi mars 1947), OC, p. 99. [58] Ibid., p. 99. [59] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 888. Des Forêts souligne. [60] Voir L.-R. des Forêts, « Sur Georges Bataille » (1958), OC, p. 897 ; voir A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 57 ; voir J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 12. [61] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 60 ; c’est ce qu’il disait déjà, en des termes presque identiques, dans Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 882 : « Menacé par sa réussite comme par son échec, tout écrivain est en état d’insécurité permanente. » [62] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 886. [63] Ibid. [64] Ibid. [65] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 60 ; L.-R. des Forêts, « Réponse à l’enquête “Pourquoi écrivez-vous ?” » (1985), OC, p. 85 : « Où est le but visé, quel est-il et, à supposer qu’on l’atteigne jamais, qu’en espérer ? À cette dernière question du moins on peut sans risque de se tromper répondre par rien. » [66] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 882. [67] Moyens et techniques ne semblent pas synonymes chez des Forêts, bien que les notions soient contiguës ; voir L.-R. des Forêts, « Sur Georges Bataille » (1958), OC, p. 897 : « Qui a lu le dernier roman de Georges Bataille ne peut que douter des moyens précaires dont usent aujourd’hui nos romanciers qui naïvement subordonnent le renouvellement de leur art à celui des techniques ». [68] L.-R. des Forêts, « Les concerts de la Pléiade » (1946), OC, p. 644. [69] L.-R. des Forêts, « Stravinski et Webern au Domaine musical » (1957), OC, p. 649. [70] Ibid. [71] Ibid. [72] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 886. [73] Ibid., p. 880. Des Forêts souligne. [74] L.-R. des Forêts, « Stravinski et Webern au Domaine musical » (1957), OC, p. 649-650. [75] L.-R. des Forêts, Le bavard (1946), OC, p. 596. [76] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 894. [77] L.-R. des Forêts, « Réponse à l’enquête “Pourquoi écrivez-vous ?” » (1985), OC, p. 85. [78] L.-R. des Forêts, « Lettre à Michel du Boisberranger » (mardi mars 1947), OC, p. 97. [79] Voir R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4 ; voir aussi A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 63-64 et 67 ; J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 19 et 27-28. [80] R. Proslier, « Instantané Louis-René des Forêts » (1960), p. 4 ; l’auteur parle du recueil La chambre des enfants (1960) ; voir aussi M. Alphant, « Louis-René des Forêts à silences rompus » (1984), p. 31 : « je n’aime pas parler d’intention parce que j’en ai très peu ». [81] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 70 ; voir aussi p. 61. [82] J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 13 ; J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 19. [83] A. Veinstein, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (1983), p. 61. [84] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 894. [85] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 894. [86] Ibid. [87] Ibid., p. 888 ; voir aussi L.-R. des Forêts, « Le droit à la vérité », OC, p. 66. [88] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 889. [89] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 882. [90] Ibid., p. 888. [91] Ibid., p. 887. [92] Ibid. [93] Ibid. [94] Ibid., p. 891. [95] Ibid., p. 886. [96] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 889-890. [97] Ibid., p. 890. [98] Ibid., p. 882. [99] Ibid., p. 884. [100] L.-R. des Forêts, Dans un miroir (1960), OC, p. 823. L’expression apparaît dans le contexte d’une semblable contradiction à la p. 834. [101] Sans faire le catalogue exhaustif de toutes les occurrences de l’expression, on peut relever d’autres exemples : ainsi, des Forêts, abordant le mensonge des dirigeants qui finissent par se tromper eux-mêmes et par n’être crus de personne, ayant perdu le contact avec « les réalités concrètes » : « Tout se passe, à un certain échelon du pouvoir, comme si le signe survivait misérablement à la chose signifiée » (« Le droit à la vérité » (1958), OC, p. 66) ; il note ailleurs que, lorsqu’il a à s’imaginer les lieux d’une action romanesque, il les situe à des endroits réels qu’il n’a pas vus depuis longtemps ou en d’autres lieux imaginaires qui n’ont en tout cas aucun rapport avec la description donnée par l’auteur : « Tout se passe comme si la description ne servait à rien, ou du moins orientait la vision sans jamais réussir à l’imposer » (J.-P. Salgas, « Les lectures de Louis-René des Forêts » (1984), p. 12.) [102] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 895. [103] L.-R. des Forêts, Voies et détours de la fiction (1962), OC, p. 895-896. [104] J.-B. Puech et L.-R. des Forêts, « Entretien » (1988), p. 21. [105] J.-L. Ézine, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle » (1995), p. 64. [106] Ibid., p. 64. |
Bibliographie
| Ouvrages cités |
|---|
|
Des Forêts, Louis-René, Œuvres complètes, prés. de Dominique Rabaté, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2015 [OC]. C’est à partir de ce volume que les textes suivants de des Forêts ont été cités :
Entretiens, articles, correspondance : Alphant, Marianne, « Louis-René des Forêts à silences rompus », Libération, 22-23 septembre 1984, p. 30-31. Bourdet, Denise, « Louis-René des Forêts », dans Encre sympathique (première publication dans La Revue de Paris en 1954), Paris, Grasset, 1966, p. 128-138. Ézine, Jean-Louis, « Louis-René des Forêts tel qu’il parle », Le Nouvel Observateur, 16 février 1995, p. 60-65. Proslier, Roger, « Instantané Louis-René des Forêts », Nouvelles littéraires, 16 juin 1960, p. 4. Puech, Jean-Benoît et Louis-René Des Forêts, « Entretien » (remaniement par des Forêts, en 1990, d’un entretien enregistré en 1988), Cahier Louis-René des Forêts (dir. par Jean-Benoît Puech et Dominique Rabaté), no 6-7, Le temps qu’il fait, 1991, p. 17-28. Salgas, Jean-Pierre, « Les lectures de Louis-René des Forêts », La Quinzaine littéraire, no 410, 1-15 février 1984, p. 11-13. Veinstein, Alain, « Louis-René des Forêts. Entretien avec Alain Veinstein » (retranscription d’un entretien donné à l’émission Les nuits magnétiques de France-Culture en 1983), La Nouvelle Revue Française, no 559, octobre 2001, p. 49-71. Autres sources : Rabaté, Dominique, Louis-René des Forêts. La voix et le volume, Paris, José Corti, coll. « Les essais », 2002. |
