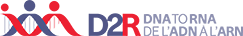Rédaction de plans rigoureux d’équité, de diversité et d’inclusion dans les appels à propositions
L’objectif ambitieux de D2R est d’incarner une approche canadienne inclusive vers des thérapies de type ARN basées sur la génomique. Par conséquent, l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) sont au cœur de l’initiative D2R et devraient être placées en priorité dans tous les audacieux projets de recherche de pointe qu’elle appuie. Le présent document d’orientation offre aux personnes souhaitant profiter des possibilités de financement de l’initiative D2R des conseils sur la préparation de sections sur l’EDI pertinentes; il n’a pas la prétention d’être une solution universelle ni une recette magique. Les sections les plus efficaces sont celles qui présentent une analyse réfléchie des enjeux et des possibilités de l’EDI en les arrimant concrètement aux projets de recherche.
Vous constaterez que ce document fait plus d’une page et vous demanderez bien pourquoi il en est ainsi. Eh bien, la vérité est que les ramifications de l’EDI dans la recherche sont multiples et qu’il faut du temps pour bien mesurer leur ampleur. Aucun défi n’étant trop grand, nous vous proposons ici un condensé qui vous permettra d’assimiler les notions de base en quelques minutes (soit à peu près le temps qu’il faudrait pour lire un article de journal dans le métro). Bien des chercheuses et chercheurs principaux souhaitent appliquer l’EDI de façon significative, mais ont de la difficulté à s’y retrouver dans les nombreuses ressources éducatives gouvernementales à ce sujet et ressentent de la frustration lors de la révision des sections sur l’EDI, car il existe peu de documents d’orientation sur la rédaction de sections sur l’EDI efficaces. Notre objectif est donc de tenter de répondre aux besoins collectifs du milieu de la recherche. Nous recommanderons fortement aux membres de l’effectif étudiant, du corps professoral, du milieu de la recherche et de la communauté élargie de l’initiative D2R de prendre part aux ateliers sur l’EDI que nous offrirons pour approfondir leurs connaissances à ce sujet. Entre-temps, nous espérons que ce document vous sera utile.
La plupart des possibilités de financement de l’initiative D2R comportent des sections sur l’EDI dans la pratique de la recherche et sur l’EDI dans la conception de la recherche. Pour orienter la rédaction de ces sections, vous trouverez ici la définition des principes de base de l’EDI, une liste de vérification et des exemples de l’EDI dans la conception de la recherche et de l’EDI dans la pratique de la recherche.
- Liste de vérification des principes de base de l’EDI avant la rédaction d’une section sur l’EDI
- Définitions
- Conseils pour éviter les erreurs courantes dans les sections sur l’EDI des appels à propositions
- Exemples d’application
Liste de vérification des principes de base de l’EDI avant la rédaction d’une section sur l’EDI
✓ Est-ce que je comprends vraiment la différence entre les trois termes (équité, diversité et inclusion) et en quoi ils sont complémentaires?
✓ Est-ce que je comprends la différence entre le sexe et le genre?
✓ Est-ce que je comprends comment ma section sur l’EDI pourrait sembler performative plutôt qu’intentionnelle?
✓ Est-ce que je connais les groupes méritant l’équité sur lesquels l’initiative D2R doit rendre compte au Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements (SPIIE)?
✓ Est-ce que je connais les erreurs typiques qui réduisent l’efficacité d’une section sur l’EDI dans une demande?
Si vous lisez attentivement toutes les sections de la colonne de gauche, nous parions que vous serez en mesure de compléter la liste de contrôle ci-dessus.
Définitions
Contrairement à la notion d’égalité, l’équité ne consiste pas à accorder le même traitement à tous. Elle repose sur la justice dans les processus et les résultats. Pour obtenir des résultats équitables, il faut souvent avoir recours à un traitement différencié et à une redistribution des ressources afin que toutes les personnes et communautés soient sur un pied d’égalité. Il faut donc reconnaître et aplanir les obstacles pour que tous puissent s’épanouir dans notre milieu universitaire.
La diversité fait référence à la présence de différences au sein d’un groupe de personnes. Dans les discussions sur l’équité sociale, la diversité vise les différences relatives, notamment, à la race, à l’appartenance à un groupe autochtone, à la classe sociale, à l’identité ou à l’expression sexuelle, à la sexualité, à l’invalidité, à l’origine ethnique et à la religion. Une réflexion sur la diversité liée à l’accès et à l’équité repose sur une connaissance et une compréhension des expériences historiques et contemporaines d’oppression et d’exclusion. La diversité doit être perçue comme un concept d’union et non de division. Elle doit nous pousser à apprécier les différences et les interdépendances, ainsi qu’à reconnaître et à combattre la discrimination systémique et institutionnalisée.
L’inclusion évoque la notion d'appartenance, le fait de se sentir bienvenu et valorisé, ainsi que le sentiment de citoyenneté. Ce terme fait également allusion à la capacité d’accéder à un établissement, à un programme ou à un environnement, et de s’y épanouir. Pour favoriser l’inclusion, il faut savoir reconnaître, aplanir et éliminer les obstacles à la participation causés par des désavantages sociaux ou une situation d’oppression. Cette prise de conscience peut entraîner la réorganisation d’un établissement, d’un programme ou d’un environnement.
Source : Plan stratégique en matière d’équité, de diversité et d’inclusion de l’Université McGill
Groupe méritant l’équité : groupe de personnes qui, parce qu’elles font l’objet de discrimination systémique, sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d’avoir le même accès aux ressources et aux occasions auxquelles ont accès d’autres membres de la société et qui sont nécessaires pour qu’elles obtiennent des résultats justes.
Source : Guide de la terminologie liée à l’équité, la diversité et l’inclusion (gouvernement du Canada)
Les groupes méritant l’équité désignés par le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, qui est le principal bailleur de fonds de l’initiative D2R, sont les personnes racialisées, les personnes noires, africaines et caribéennes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap, les femmes et les membres de la communauté 2ELGBTQIA+.
Le terme sexe renvoie à un ensemble d’attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques, par exemple les chromosomes, l’expression génique, les niveaux d’hormones et l’anatomie du système reproducteur. On décrit généralement le sexe en termes binaires, « femme » ou « homme », mais il existe des variations touchant les attributs biologiques définissant le sexe ainsi que l’expression de ces attributs.
Le terme genre renvoie aux rôles, aux comportements, aux expressions et aux identités que la société construit pour les hommes, les femmes, les filles, les garçons et personnes de divers sexes et de genre. Le genre influe sur la perception qu’ont les gens d’eux-mêmes et d’autrui, leur façon d’agir et d’interagir, ainsi que la répartition du pouvoir et des ressources dans la société. L’identité du genre n’est ni binaire (fille/femme, garçon/homme) ni statique. Elle se situe plutôt le long d’un continuum et peut évoluer au fil du temps. Les individus et les groupes comprennent, vivent et expriment le genre de manières très diverses, par les rôles qu’ils adoptent, les attentes à leur égard, les relations avec les autres et les façons complexes dont le genre est institutionnalisé dans la société.
Source : Qu’est-ce que le genre? Qu’est-ce que le sexe? (Instituts de recherche en santé du Canada
La performativité est la pratique qui consiste à effectuer un travail sur l’équité pour se conformer à la loi ou pour qu’une organisation ou une personne « fasse bonne figure » et augmente son capital social, au lieu de faire des efforts sincères pour créer un changement substantiel.
Le tokénisme, un type de performativité, est le fait de poursuivre l’inclusion ou la diversité de manière superficielle ou symbolique. Un exemple de tokénisme est le recrutement d’individus issus de groupes sous-représentés pour créer une apparence de diversité sans prendre de mesures pour remédier aux inégalités sous-jacentes. D’autres exemples sont le recrutement d’une personne, l’invitation d’une personne à faire partie d’un comité ou à participer à un projet de recherche en tant que partenaire collaboratrice ou collaborateur, mais sans valoriser ses contributions, son expertise ou ses connaissances; les déclarations d’engagement public à donner la priorité à l’EDI sans financer de manière appropriée le travail nécessaire pour la soutenir au sein de l’organisation; l’attribution du travail à des personnes qui n’ont pas d’expertise pertinente ou d’expérience vécue; le fait de détourner les priorités du travail d’EDI lorsque d’autres priorités organisationnelles apparaissent ou lorsque l’urgence publique s’estompe.
Conseils pour éviter les erreurs courantes dans les sections sur l’EDI des appels à propositions
Il n’est pas rare qu’une mauvaise compréhension des principes de base se traduise par certaines erreurs courantes dans les sections sur l’EDI. Voici donc trois exemples d’erreurs courantes, accompagnés de conseils pour les éviter.
Exemple 1 : Se concentrer exclusivement sur la diversité exceptionnelle de l’équipe de recherche ou du personnel du laboratoire de recherche.
En quoi est-ce une erreur? La diversité n’est pas un gage d’équité et d’inclusion dans les pratiques de recherche. L’emploi approprié des termes « équité » et « inclusion » aidera à éviter cette erreur. De plus, le volet diversité semblera plus performatif qu’intentionnel si votre proposition ne démontre pas systématiquement les mesures de sensibilisation spécifiques prévues pour attirer et retenir les membres des groupes méritant l’équité et les accompagner dans leur cheminement professionnel.
*** L’identification des membres de l’équipe et la présentation d’un recensement soulèvent des questions éthiques puisque les données d’auto-identification peuvent être de nature délicate. Voici un exemple d’une déclaration inappropriée : « Trois des membres de mon équipe viennent de XX pays et deux sont des femmes. De plus, l’équipe compte aussi une personne membre de la communauté 2ELGBTQIA+. »
Exemple 2 : Se targuer d’une affiliation à des unités ou des instituts de recherche de l’Université McGill qui sont reconnus pour leurs pratiques exemplaires en matière d’EDI sans expliquer précisément l’arrimage entre l’EDI et le projet de recherche.
En quoi est-ce une erreur? Cette façon de faire illustre que les personnes à l’origine de la demande n’ont pas pris le temps de réfléchir aux enjeux et aux possibilités de l’EDI propres à leur projet de recherche. Par exemple, une section sur l’EDI efficace relèvera tous les enjeux de l’EDI liés aux iniquités dans le traitement, à l’accès, à la méfiance, à la reproductibilité ou au risque de préjudice dans le contexte du projet de recherche.
Exemple 3 : Ne pas mentionner les possibilités de collaboration avec les groupes méritant l’équité lors de la conception de la recherche.
En quoi est-ce une erreur? Pour renforcer la confiance et la responsabilisation des groupes méritant l’équité dans la médecine génomique et le développement de thérapeutiques à base d’ARN, il ne suffit pas de mener des recherches qui contribuent à mettre au point des vaccins et des drogues pour tout le monde. Pour être véritablement inclusive, la conception doit être réalisée pour, par et avec tout le monde. Cette position repose sur le principe « Rien sur nous sans nous », qui est l’une des pratiques exemplaires de l’EDI les plus efficaces lorsqu’il s’agit de la conception de la recherche. Ainsi, la meilleure intégration de l’EDI à la conception de la recherche démontre :
- l’inclusion des groupes méritant l’équité dans les discussions informelles ou les consultations officielles sur l’élaboration de la question de recherche;
- l’inclusion, dans la mesure du possible, d’une revue d’écrits provenant de différents pays ou de scientifiques membres de groupes méritant l’équité (la reconnaissance de certaines lacunes ou de l’absence de ces types d’écrits qui s’inscrit dans un processus rigoureux peut également être bien perçue par les personnes évaluant l’EDI);
- pour la recherche avec des animaux : inclusion d’échantillons de femelles et de mâles pour mettre en évidence la capacité explicative des similitudes et différences dans l’épidémiologie de la maladie à l’étude, saisir les occasions de découvrir les différences entre les sexes et améliorer la santé en modulant les traitements selon le sexe;
- pour la recherche avec les êtres humains ou la science des données humaines : inclusion de données de personnes d’une grande mixité (groupes d’âge, régions, sexe, genre, race, ethnicité, antécédents socioéconomiques, etc.) pour développer des thérapeutiques à base d’ARN plus robustes, stimuler l’innovation pour faciliter l’instauration de la confiance, ainsi que garantir l’accès universel à de telles thérapeutiques et à des politiques sanitaires inclusives;
- l’analyse des différences et des similitudes dans la diversité de l’ensemble de données étudié. Cette analyse peut également comprendre des limites et inviter d’autres projets de recherche à reproduire la recherche en question avec les groupes méritant l’équité qui ne faisaient peut-être pas partie du contexte du projet de recherche;
- des stratégies efficaces pour s’assurer que l’application et la diffusion des connaissances rejoignent le plus grand nombre de personnes possible. Parmi les exemples permettant d’illustrer ce point, notons la rédaction d’un résumé vulgarisé, la traduction des résultats de recherche dans la langue de la communauté étudiée, la production de versions audio pour les personnes des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire qui sont peut-être analphabètes, le partage avec les associations de recherche dirigées par les groupes méritant l’équité, etc.
*** Nous comprenons que l’intégration de l’EDI n’est pas toujours possible. Toutefois, un plan rigoureux d’EDI doit inclure une justification réfléchie expliquant comment et pourquoi les volets d’EDI ne s’appliquent pas.
Exemples d’application
EDI dans la pratique de la recherche (cette liste n’est pas exhaustive)
- Équité – Offrir des possibilités de recherche pour appuyer le recrutement, le maintien en poste et le développement professionnel de membres de groupes méritant l’équité grâce à la sensibilisation, aux pratiques exemplaires d’embauche en matière de diversité, aux mesures d’adaptation, aux mesures d’accessibilité, au mentorat et aux commandites. Diffuser stratégiquement les possibilités liées à la gouvernance, aux conférences, aux publications et à l’emploi.
- Diversité – Assurer la mixité de l’équipe de recherche en adoptant des pratiques intentionnelles de recrutement et d’embauche.
- Inclusion – Favoriser le sentiment d’appartenance et la valorisation des membres de groupes méritant l’équité dans les interactions de recherche grâce à des pratiques intentionnelles de collaboration bienveillante fondée sur l’EDI.
EDI dans la conception de la recherche (cette liste n’est pas exhaustive)
- Participer à des ateliers sur l’EDI dans la recherche (seront développés par l’initiative D2R en 2025-2026).
- Inclure les considérations relatives au sexe et au genre dans les recherches en santé, le cas échéant.
- Inclure divers points de vue à différentes étapes de la conception de la recherche, y compris :
- en consultant les membres de groupes méritant l’équité pour contribuer à l’élaboration de la conception des questions de recherche;
- en incluant des écrits d’une variété de pays et de cultures dans la revue de la littérature;
- en utilisant divers ensembles de données et diverses méthodes d’analyse pour favoriser des résultats inclusifs;
- en adoptant une stratégie de diffusion des connaissances qui rejoint divers publics (milieu scientifique, groupes de patients et patientes, organismes communautaires);
- en planifiant l’évaluation des retombées potentielles du projet de recherche pour les groupes méritant l’équité.