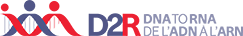Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients des menaces microbiennes, il n’a jamais été aussi important de comprendre les minuscules organismes qui nous entourent. Et si nous pouvions mieux comprendre ces microbes grâce au pouvoir des jeux vidéo?
Le projet financé par D2R, « A citizen science platform for accelerating metagenomic studies in urban built environments », dirigé par le professeur de l’Université McGill Jérôme Waldispühl, en collaboration avec le professeur Rees Kassen, modifie notre compréhension des microbes en combinant la recherche scientifique et le pouvoir des jeux vidéo.
Le monde microbien sous nos pieds
Le professeur Kassen, biologiste et responsable de l’initiative CUBE (Coronavirus dans l’environnement bâti urbain) explique : « Les microbes nous entourent en tout temps. Nous savons rarement qu’ils sont là, sauf lorsque des problèmes surviennent – lorsque nous devons lutter contre une infection. » Son équipe se concentre sur la cartographie des microbes dans les milieux collectifs (endroits où les gens ont tendance à se rassembler), comme les hôpitaux, où des virus comme la COVID-19 peuvent « s’installer » sur les surfaces. « Les planchers agissent comme des éviers », explique M. Kassen. Ses recherches ont démontré que l’écouvillonnage de surfaces comme les planchers et l’analyse des matériaux microbiens pourraient permettre de prédire des éclosions virales dans les foyers de soins de longue durée jusqu’à une semaine à l’avance. Cette capacité de prédire les éclosions avant qu’elles se propagent change la donne en ce qui concerne la surveillance en temps réel de la santé publique.
Toutefois, un des principaux défis de la recherche microbienne est la prise en compte du volume massif de données génétiques qui doivent être analysées en peu de temps.
La science ludique pour lutter contre la surcharge de données
Pour relever ce défi, le professeur Waldispühl combine l’intelligence artificielle (IA) et la créativité humaine. « L’IA a des limites parce qu’elle est mise en place dans des ordinateurs […] à l’opposé, les humains sont beaucoup plus lents, mais beaucoup plus créatifs et souples », explique-t-il. En faisant participer les joueurs dans des jeux vidéo pour résoudre des énigmes fondées sur le séquençage de l'ADN, le projet tire parti de la créativité de millions de personnes qui permettent de mettre en évidence erreurs que les ordinateurs pourraient laisser passer, ce qui améliore l'exactitude des données génomiques.
Dans la première phase du projet, M. Waldispühl s’est associé à plusieurs personnalités clés pour donner vie à cette idée. Attila Szantner, professeur associé à l’École d’informatique de l’Université McGill et PDG et cofondateur de Massively Multiplayer Online Science (MMOS), et Randy Pitchford, président de The Gearbox Entertainment Company, ont joué un rôle déterminant dans la création et l’intégration d’un « mini jeu scientifique » dans Borderlands 3, un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Plus de cinq millions de joueurs ont participé à ce mini jeu, dans lequel ils ont résolu plus de 150 millions de casse-tête ressemblant à Tetris, et les données recueillies ont permis de construire un arbre phylogénétique des microbes intestinaux humains. Cette combinaison de l’apport humain et de l’IA crée un cycle qui bonifie les données, dégage des résultats plus exacts et améliore l’analyse scientifique.
Tablant sur le succès de la première phase, le projet est maintenant réalisé dans les applications mobiles et mobilise encore plus de joueurs dans cette initiative de science citoyenne.
Une vision d’inclusivité et d’engagement scientifique
Pour le professeur Waldispühl, l’utilisation des jeux vidéo dans le projet poursuit deux objectifs : faire progresser l’analyse des données et rendre la science accessible à tous. « La science n’est pas si compliquée; en fait, elle est amusante, affirme M. Waldispühl. Et ils [les joueurs] peuvent se fixer un but en le faisant et en se plaisant à le faire. » En intégrant la science citoyenne à des jeux populaires, le projet atténue les obstacles à l’engagement scientifique, permettant aux gens de traiter des questions complexes sans se heurter au jargon intimidant souvent associé à la recherche.
Les joueurs ne font pas que résoudre des casse-tête : ils contribuent activement à la compréhension scientifique des microbes et au rôle de ces derniers dans la santé publique. « Le fait d’intégrer la science au jeu abaisse la barrière d'entrée. Vous n’aurez jamais peur d’un problème scientifique, parce que vous savez qu’il est là pour vous divertir », affirme M. Waldispühl.
Des données à l’action
En définitive, l’objectif de cette recherche n’est pas seulement de recueillir des données, mais de les transformer en renseignements exploitables qui améliorent la santé et la sécurité. « Si nous pouvons identifier rapidement les agents pathogènes présents dans un hôpital ou un foyer de soins, nous pouvons aider les cliniciens à réagir plus efficacement, déclare le professeur Kassen. L’espoir est d’envisager qu’il y aurait des traitements si nous savons ce que nous traitons. »
En tirant parti du pouvoir de la science citoyenne, de l’IA et du jeu vidéo, l’équipe se donne comme but d’améliorer les mesures de lutte contre les infections et de veiller à ce que les interventions soient rapides et efficaces.
Pour en savoir plus sur les recherches menées par le professeur Waldishpul, regardez ci-dessous